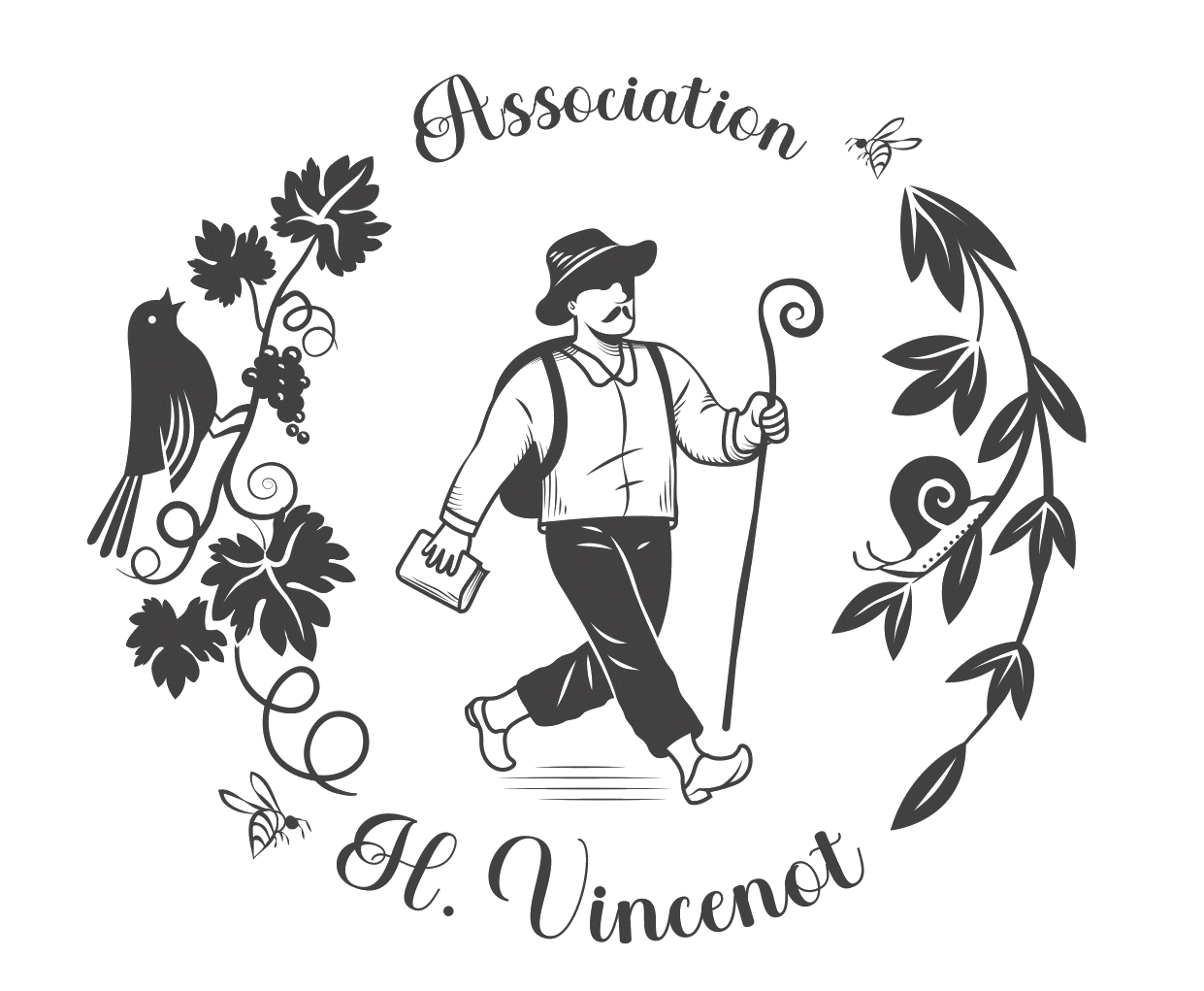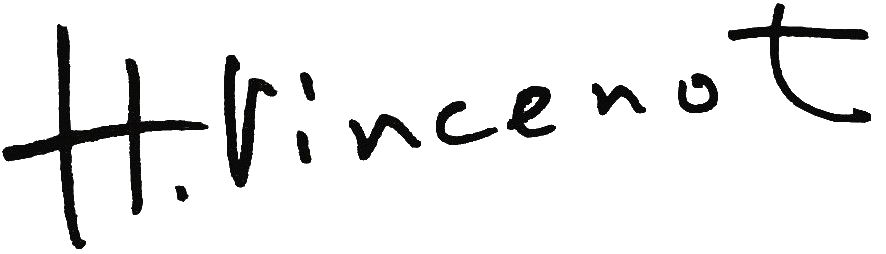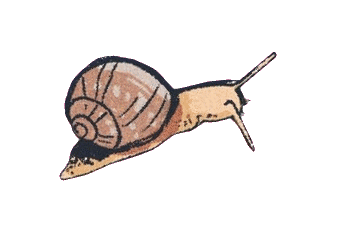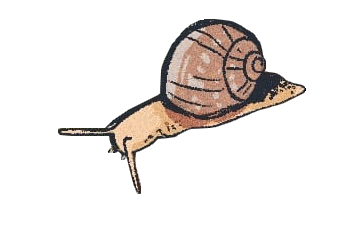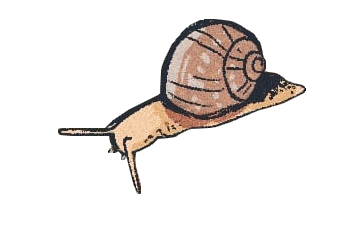Mars-Avril 2025
Les horizons culinaires d'Henri Vincenot, Bourguignon salé

Photographie d'Henri Vincenot. Fonds Vincenot, BPE de Dijon.
Le foyer primordial
C’est un jour humide mais ensoleillé de septembre 1929, dans les combes boisées qui surplombent La Bussière-sur-Ouche, qu’une rencontre décisive bouleverse l’existence d’Henri Vincenot.
Alors qu’il est aux trousses de trois jeunes chiens de chasse qui avaient « levé » un chevreuil, le futur auteur de La Billebaude[1] découvre un hameau en ruine[2] qui devient, dès lors, sa préoccupation principale, le moteur de son œuvre et le cœur de son plus grand succès éditorial. Motif décliné dans ses romans, ses récits, sa peinture et ses dessins, le hameau en ruine de « La Peurrie » prend une dimension plus importante encore lorsque, en 1978, Vincenot en fait le théâtre d’une communion amoureuse entre le narrateur de La Billebaude et une jeune femme du nom d’Andrée (p. 420-423). Dans cette scène, fortement autobiographique, Henri Vincenot dépeint la rencontre entre la Bourgogne vineuse des Maranges (du côté de Chagny, entre Côte-d’Or et Saône-et-Loire), d’où vient la jeune femme, et la Bourgogne montagnarde (du côté de la vallée de l’Ouche) dont le narrateur, jeune Auxois, est originaire, tout comme Vincenot. Représentée à travers les nuances qui distinguent les parlers des deux personnages, cette rencontre de deux « tribus » (p. 414) se joue autour d’une mise en scène culinaire : le saucisson brioché et les gougères de la fille des Maranges côtoient la gibelotte et les fromages et flans montagnards, alors que c’est dans le Joudru de Nolay (p. 421), ville frontalière, que se rejoignent et se marient deux horizons culinaires voisins et pourtant différenciés.
La portée symbolique de ce passage de la fin de La Billebaude est multiple et, si elle semble rejoindre le sens accordé traditionnellement à un tel événement[3], elle revêt une signification particulière dans le contexte de ce roman. Les deux amoureux, qui se sont rencontrés lors d’une « paulée », ces banquets bourguignons de fin de vendanges, scellent leur union autour d’un premier festin intime et, malgré la méfiance ancestrale de la famille – marquée par les frontières « séparant encore deux tribus gauloises » –, épousent ce moment intime qu’est le repas en « Bourguignon[s]-Salé[s] » qui partageraient, se demande Vincenot sur le ton de la question rhétorique, « à quelques expressions près, le même parler, la même rondeur du verbe ? Le même amour sensuel et absolu : tellement sensuel qu’il tournait à la mystique, tellement absolu qu’il atteignait carrément au fatum des Anciens ? … »
Symbole de la renaissance du hameau perdu et prélude à « l’œuvre de chair »[4] nous suivrons Henri Vincenot sur les sentes de ses horizons culinaires, des « imageries » ethnographiques aux méandres mystiques en passant par l’affirmation d’un primum vivere envers et contre tout, jusque dans les cendres ranimées du hameau de « la Peurrie ».
L’imagier
C’est à l’automne 1978[5] que la maison Denoël, laquelle édite Vincenot depuis ses débuts[6], propose à son auteur d’écrire un livre pour la collection « Cuisines du terroir ». Auréolé du succès fulgurant de La Billebaude, roman sorti en cette année 1978, Vincenot accepte la proposition qui aboutit, en 1979, à un ouvrage intitulé Cuisine de Bourgogne, et signé « Famille Vincenot »[7]. La dimension collective de cet ouvrage ne provient pas seulement du fait que c’est toute la famille qui fut mise à contribution. Andrée [sa femme] « recherche les recettes les plus traditionnelles dans les cahiers manuscrits par les grands-mères »[8], et « François [l’un de ses trois fils, qui tient alors une auberge à Sombernon] livre quelques secrets de ses plats les plus réussis »[9]. L’ouvrage est aussi marqué par un souci technique, car Nathalie [petite-fille de Vincenot, fille aînée de Claudine] « qui vient de rédiger un mémoire de maîtrise de lettres sur "Le vocabulaire du vin" est chargée de rendre par les mots la saveur des plats »[10]. Plus encore que dans sa conception, c’est dans l’objet livre que s’exprime pleinement ce travail de famille : les vingt-sept premières pages de l’ouvrage sont en effet consacrées à des photographies de famille qui livrent parfois les visages des personnages[11] qui ont participé du succès de La Billebaude, vivement inspirés de personnes réelles de l’entourage d’Henri Vincenot. Ainsi, le lecteur de Cuisine de Bourgogne peut découvrir le visage de Joseph Brocard dit « Tremblot » (pp. 16-17), grand-père maternel de Vincenot, personnage central du roman précédemment cité, qui s’occupe du gibier de la chasse jusqu’à la cuisson, ou encore « Nanette » Brocard (p. 12), arrière-grand-mère maternelle et guérisseuse, dont les recettes dépassent de loin le simple cadre des soins. À cela s’ajoutent encore les photographies des parents de l’écrivain, de la famille de sa femme, des enfants et petits-enfants, sans oublier la photographie d’une partie de pêche sur le lac de Commarin[12] qui servit d’ailleurs de couverture à la première édition de l’ouvrage. Voilà donc le cadre familial posé, qui peut laisser place au texte d’Henri Vincenot, mise en bouche proposée « en guise de préface » (p. 39), le tout dans un ouvrage que l’écrivain perçoit comme « un complément culinaire de La Billebaude »[13]. Après avoir associé la cuisine de Bourgogne aux visages de plusieurs générations de Bourguignons de la Montagne[14], Vincenot rappelle, dès la première page de son texte, que la cuisine est avant tout une question géographique, « car rien ne fait mieux apprécier un mets comme de connaître la figure du lieu où il fut conçu et la façon qu’ont les rivières d’y gambader » (p. 40). Et Vincenot d’user d’une antanaclase qui est aussi syllepse in absentia pour nommer « une chère qui [lui] est chère » (p. 41), liant ainsi une bonne fois pour toutes et dans un ensemble sacré, un « monument » (p. 41), la chair et la bonne chère avec la terre, un terroir et un territoire.
Avant même de commencer à donner les ingrédients qui servent de base à la cuisine qu’il s’apprête à décrire, Vincenot a le souci de nuancer le titre donné à l’ouvrage, sans aucun doute orienté par la double nécessité de cette collection d’attirer en même temps le lecteur avec la promesse de recettes du terroir, tout en désignant ce terroir sous une appellation somme toute très vague et trop large pour y correspondre pleinement. Vincenot remédie donc immédiatement à cet écart, et va même plus loin : fidèle à l’idée qu’il développe dans La Billebaude selon laquelle sa manière de faire de la géographie est un « prodigieux monument de subjectivité » (p. 207-208), il insère, en guise de conclusion de sa préface, une carte du « Toit du monde occidental », ce qui ancre définitivement les recettes de l’ouvrage dans un pays particulier caractérisé par une culture, des traditions et des caractères communs, un terroir, en somme. Cette expression de « Toit du monde occidental », maintes fois reprise par Henri Vincenot pourrait souffrir diverses définitions. Thème récurrent sous la plume de l’écrivain, c’est dans La Billebaude, qu’il en donne une description qui précise la nature profonde qui caractérise le territoire dont il est question (p. 39) :
« Cette montagne sacrée [le Mont Beuvray] ressemble à une grosse bête assoupie sur l’horizon avec sa nuque épaisse, saillant entre ses deux épaules. Dans la dépression, brillent les aiguilles d’acier du canal de Bourgogne, les flaques ovales des trois lacs et les fils d’argent d’un curieux lacis de rivières qui, sans en avoir l’air, ont une particularité extraordinaire et magique, celle de partager nos eaux entre la Manche, l’Atlantique et la Méditerranée. Ce qui fait dire à mon grand-père que notre vieille tribu tient le Toit du Monde occidental, ni plus ni moins. »
L’eau est ce qui délimite, anime et étend le « Toit du monde occidental », point de départ de ce livre de cuisine. L’eau et le vin sont aux sources de l’ouvrage et constituent les bases de la cuisine « chère » à Vincenot – qui représente les principaux cours d’eau sur son croquis du « Toit du monde occidental » – et qui y ajoute la crème, la graisse de porc et le pâton (p. 45), eux-mêmes issus de cette eau qui le fascine tant. Ils sont les fruits de cette « particularité » extraordinaire et magique. Magique tout comme les propriétés de l’eau du puits du Tremblot, dans La Billebaude (p. 396) :
« — Tremblot, votre jambon persillé est unique au monde !
Il répondait :
- C’est l’eau !
- C’est l’eau ?
- Oui, l’eau du puits !
Il tenait dur comme fer que les qualités exceptionnelles de ce jambon rituel venaient de l’eau de notre puits où, pendant trois jours de la Semaine sainte, on le mettait à dessaler… »
La cuisine que s’apprête à décrire Vincenot ne saurait donc être envisagée sans le « Toit du Monde occidental », de même qu’à ce dernier manquait la description précise de la cuisine qui le caractérise. Point de départ et aboutissement de cet ouvrage, il est nécessaire que le lecteur, au terme de cette préface plurielle, ait conscience de l’ensemble culturel, linguistique et géographique d’envergure dans lequel s’inscrivent les plats qu’il pourra confectionner.
Cet ouvrage consacré à la cuisine se situe donc dans une entreprise plus vaste menée par l’auteur dans l’intégralité de son œuvre : la plupart de ses romans sont consacrés entièrement à ces « hauts pays bourguignons », ou l’évoquent en partie, sans parler de l’œuvre peint de Vincenot, qui y consacra de nombreuses toiles. Parfaitement inscrit dans la démarche d’ « imagier »[15]» que mène un auteur qui ne s’interdit aucune forme d’expression pour enluminer son « haut pays », Cuisine de Bourgogne devient le pendant pratique de romans (dont La Billebaude et Le Pape des escargots[16] sont les exemples les plus cités), de peintures, de fresques[17], de nouvelles et récits (Récits des friches et des bois[18], Prélude à l’aventure[19]) et d’ouvrages à vocation plus historique, voire ethnographique (La Vie quotidienne des paysans bourguignons au temps de Lamartine [20], Canaux de Bourgogne[21]).
Poétiques de la symphonie
Une fois que le lecteur est initié en théorie à la nature du terroir dont sont issus de tels plats, il incombe à l’auteur de restituer la pratique, les gestes d’une discipline qu’il associe d’emblée au sacré, car « pour nous, écrit Vincenot dans sa préface, manger n’est pas seulement une affaire d’estomac. L’esprit, la mémoire, y ont part égale. La cuisine est ici bien plus une philosophie qu’une technique. » (p. 42) La cuisine est envisagée comme un espace à part dans la maison : la cuisine a ses prêtresses, les « enviables vestales » (ibid.) qui s’occupent du sacrifice dans des lieux sacrés, saturés de senteurs et de couleurs :
« Toutes ces femmes avaient passé deux jours à dépiauter, à mignarder cette chair musquée comme truffe, pour la baigner largement dans le vin du cousin, où macéraient déjà carottes, échalotes, thym, poivre et petits oignons. Tout cela brunissait à l’ombre du cellier dans les grandes coquelles en terre. C’était moi qui descendais dans le cellier pour y chercher la bouteille de vin de table et lorsque j’ouvrais la porte de cette crypte, véritable chambre dolménique qui recueillait et concentrait les humeurs de la terre, un parfum prodigieux me prenait aux amygdales et me saoulait à défaillir. C’était presque en titubant que je remontais dans la salle commune, comme transfiguré par ce bain d’effluves essentiels et je disais, l’œil brillant :
— Hum ! ça sent bon au cellier ![22] »
Les horizons culinaires d’Henri Vincenot dépassent largement le cadre de la table : la terre et ses composantes en constituent l’origine, le fondement. Le narrateur de La Billebaude, profane, descend dans cet autre espace sacré, qui accompagne la cuisine, le cellier, dans lequel il se rend comme dans une « crypte », le considérant comme une « véritable chambre dolménique »[23]. C’est de la terre que proviennent les denrées du cellier, et c’est dans les entrailles de la terre qu’elles sont conservées, bonifiées avant d’être transformées dans l’autre temple où sont gardés les instruments du culte. De la même manière que c’est « l’eau du puits » du Tremblot de La Billebaude qui fait de son jambon persillé le meilleur, la confection d’un repas telle que l’envisage Vincenot n’est pas la même si la « vestale » ne dispose pas des objets nécessaires au bon déroulement du culte : « Heureux sont ceux qui, même dans les maisons les plus "modernes", ont su encore ménager la place d’un fourneau, d’une cuisinière, d’un âtre et d’un bûcher, éléments essentiels de la vie familiale.[24] »
Le feu est un élément récurrent dans l’œuvre de Vincenot, qui nourrit cette fascination depuis sa rencontre avec Gaston Bachelard[25] notamment. Il est donc naturel que le feu qui « monte des profondeurs »[26] soit essentiel au bon déroulement du rituel : « La flamme ! Centre de toutes nos rêveries, même de nos hypnoses collectives à la veillée. Le feu ! »[27]. C’est ainsi que le « fourneau » ou « l’âtre », qui captent cet autre élément que Vincenot conçoit comme un fruit de la terre, assument la fonction d’être en quelque sorte le saint des saints, le lieu de la métamorphose, thématique qui résonne, sous la plume de Vincenot, très fortement avec la « transmutation » dont il est souvent question dans ses romans publiés après 1970. Dans ces textes les églises sont volontiers considérées, par le truchement de personnages mystiques tels que la Gazette (Le Pape des escargots) ou le Prophète (Les Étoiles de Compostelle[28]) comme des « athanors » bâtis pour la « transmutation » des hommes et la « régénération »[29] du genre humain. Il n’est pas anodin que Vincenot insiste dès sa préface à Cuisine de Bourgogne sur la nécessité du feu pour accomplir la conception du repas. Fidèle à l’idée que cet ouvrage est un « complément culinaire de La Billebaude », Vincenot rédige ces conseils en écho à plusieurs passages de La Billebaude, dont le suivant (p. 115-116) est sans doute le plus représentatif :
« C’est aussi dans la chambre à four, cette crypte sainte, que l’on faisait devant le brasier, les rôtis de grand feu, l’oie à la broche, la dinde et le poulet, dans la grande rôtissoire. Oui, la chambre à four, avec ses lourdes tentures de toiles d’araignée suspendues aux chevrons, ses murs nus et sa suie séculaire, c’était l’athanor où le feu se transformait en principe de vie ; voilà pourquoi je m’y réfugiais, pour y renifler dix siècles de ce vrai confort, qu’on n’a d’ailleurs jamais remplacé, et pour y mijoter les expériences gustatives personnelles, les seules valables. »
Le vocabulaire liturgique côtoie ici un lexique sensoriel qui restitue le mélange de déférence et d’émerveillement saisissant le profane à l’entrée d’un lieu où se jouent les mystères de la transformation d’une matière née de la terre, façonnée par l’eau, et métamorphosée par le feu. La différence qui existe entre La Billebaude et Cuisine de Bourgogne réside principalement dans le fait que le narrateur du roman appartient en quelque sorte au monde profane qui s’invite dans l’espace sacré de la composition d’un repas, alors que, dans le second ouvrage, c’est Vincenot qui initie le lecteur et le guide dans son apprentissage. Le roman présente un horizon mystérieux, exprimé à recours de champs lexicaux et sémantiques : les découvertes du narrateur sont essentiellement sensorielles et sont présentées comme la réminiscence de souvenirs passés. Le changement de point de vue qui s’opère dans Cuisine de Bourgogne produit une bascule, une légère ouverture dans le domaine du secret est permise par celui-là même qui l’a instaurée dans La Billebaude, et qui exhorte désormais son lecteur à « s’imbiber d’un principe » (p. 52) que voici :
« Il n’est pas question de confectionner des plats, fussent-ils les plus prestigieux.
C’est un repas qu’il faut composer.
Là, je me rends compte que je vais, maladroitement sans doute, toucher carrément à la philosophie pure […]. »
Vincenot franchit ainsi la barrière qui sépare le récit romanesque du livre de recettes, sans toutefois briser jamais le lien qui les retient et qui produit ce mélange d’action, de praxis et de création, de poïésis, qui aboutit à une réflexion pratique sur l’acte de « composer un repas ». Fidèle à sa propre pratique de l’art, qui fait de lui un artiste complet et polyvalent[8], Vincenot considère que la composition d’un repas s’inscrit sur le même plan que la création « d’une œuvre d’art », elle-même envisagée comme « un tout exhaustif » : « Composer et créer un repas est du même ordre que créer un poème, une symphonie, un tableau, et manger, pour être un acte nécessaire et plusieurs fois quotidien, n’en est pas moins une manifestation solennelle de l’amour de la vie.[30] »
Cette volonté de mêler des éléments poétiques et propres à un acte de foi, à la dimension pratique d’une recette de cuisine se retrouve déjà partiellement dans certains extraits de La Billebaude (p. 114) comme dans l’exemple suivant :
« Ou bien encore, et là on atteint les très hautes cimes de la gastronomie de chambre à four : faites griller sous la cendre une douzaine d’escargots, dans leur coquille et, sans en enlever le tortillon surtout, mangez-les brûlants avec de la purée d’orties judicieusement salée et poivrée. C’est la Gazette qui m’avait donné cette recette en me disant : "Cré lougarous ! L’ortie, c’est plein de fer ! Ça te fait les nerfs comme des rains de cornouiller !" Quant à l’escargot, tout le monde sait qu’il donne la vie éternelle, ou presque. N’est-il pas tous les hivers, enfermé dans son sépulcre (sa coquille), recouvert d’une dalle (le couvercle) et ne ressuscite-t-il pas tous les ans, vers Pâques ? Mystère prodigieux qui vous entre dans les veines et dans le sang quand vous le mangez. »
Cet extrait du roman, en plus de présenter des similitudes avec le ton adopté dans Cuisine de Bourgogne, illustre l’importante porosité qui caractérise le dialogue des œuvres d’Henri Vincenot entre elles. La cuisine ne saurait s’envisager sans la dimension symbolique ou, comme dans l’extrait précédent, mystique qui l’accompagnent, de même qu’on ne doit pas « massacre[r] […] les escargots en les ramassant entre le 15 mai et le 10 septembre » (p. 73) ou que « le chevreuil demande à être mangé dans les 3 heures de l’abattage » sans quoi « il préfère attendre 3 jours au moins » (p. 176). De la chasse à la cuisson, de la récolte à l’assiette, les horizons culinaires que Vincenot imagine à travers le couple La Billebaude-Cuisine de Bourgogne demandent, comme toute initiation, une implication totale de l’initié, qui doit suivre, pour respecter la « symphonie »[31], la poétique culinaire qui fait le « chef-d’œuvre »[32] et qui ordonne jusqu’à la disposition des recettes dans l’ouvrage. Présentées en commençant par les soupes et en terminant par les liqueurs, le sommaire de l’ouvrage arrange les mets en suivant une succession d’assiettes, qui va de la première à la cinquième, sans oublier l’apport des fromages, des desserts et confitures qui achèvent la « symphonie ». Ainsi, le lecteur peut composer un menu intégralement bourguignon : les attendus qui vont de pair avec la collection dans laquelle s’inscrit l’ouvrage sont respectés, et la volonté de totalité qui caractérise l’écriture d’Henri Vincenot est assouvie. On pourrait encore s’attarder à évoquer la chasse – et le braconnage – dans son ensemble, partie intégrante des horizons culinaires de Vincenot, thème centrale de La Billebaude et motif important de Cuisine de Bourgogne ; l’apiculture, élément chargé de symboles mystiques ou bien l’observation des méthodes de chasses des animaux ou encore les relevés méthodiques de leur passage que l’auteur accomplissait. Vastes et variés, les horizons culinaires de Vincenot dépassent de loin les murs de la cuisine et épousent le désir de totalité de l’écrivain.
Amour de la vie, primum vivere
La question de l’intratextualité, soulevée par le rapprochement du roman La Billebaude et de Cuisine de Bourgogne, ne se limite évidemment pas aux années 1978-1979. La première évocation majeure d’un motif culinaire travaillé par Vincenot date de 1942 et prend la forme d’un court roman, Le Livre de raison de Glaude Bourguignon[33]. La guerre s’est terminée dès l’hiver 1939[34] pour Henri Vincenot et, après les troubles de l’exode, la famille Vincenot se fixe à Talant, village happé par Dijon, dans le quartier des Buissonets. C’est là qu’il entreprend « une entreprise de résistance au malheur »[35] qui aboutit au roman signé « Henri Vincenot, sculpteur-imagier, les Buissonnets, Talant, 1942 » (p. 185) , et dont l’épigraphe « primum vivere » (p. 13), détonne en cette période de restriction, de froid et de danger. Glaude – qui a de nombreux traits en communs avec Henri Vincenot – se joue, avec la complicité des siens, de la vigilance de l’occupant dans le but de se remplir la panse de tous les mets sur lesquels il peut mettre la main. Après un court résumé de la situation et un réquisitoire contre la guerre, le narrateur, Glaude Bourguignon, débute le récit de ses escapades de braconnier[36], accomplies soit avec la complicité de son beau-père, qui n’est jamais le dernier « grand gosier » (p. 37), soit de sa femme « bon prêtre de ce culte que j’ai [Glaude Bourguignon] voué à la bonne chère » (p. 101). La seule guerre légitime, pense Glaude bourguignon, est celle que l’on fait aux estomacs vides (p. 58-59) :
« Cette bouillie [une omelette] n’est pas avalée que mon estringoire m’avertit que, si la qualité fut de la fête, la quantité manquait. Et me voici, l’œil aux aguets, cherchant en toutes les assiettes, en tous les pots, en toutes les soupières pour faire la guerre au seul ennemi héréditaire que je me connaisse : la faim !
Voilà une bonne guerre, voilà une œuvre utile et stimulante que de pourchasser cet ennemi-là ! J’y apporte toute l’ardeur de la race (qu’il me soit permis de prononcer là ce mot, par ailleurs insignifiant), j’y mets tout mon bonheur, qu’on s’en rapporte à moi, et toute ma perspicacité.
Tout à l’heure, nous prendrons la bêche, peut-être, mais en attendant manions la fourchette, cette arme merveilleuse. »
En temps de guerre et de manque, la forte dimension mystique qui relient les horizons culinaires de Vincenot est moins présente, sans pour autant retirer au repas sa dimension sacrée. La dimension sacrificielle de la guerre est transférée sur les mets – dans ce roman : les œufs, le pain, le vin et le cochon, qui se retrouvent en bonne part dans les ingrédients de bases énoncés dans Cuisine de Bourgogne – et la violence que Glaude pourrait exercer est reportée sur les denrées qui croisent sa route. Dans La Billebaude, la faim qu’entraîne le Carême prépare les joies de Pâques ; mais dans Le Livre de raison, les privations, volontaires ou subies, ont un tout autre sens. Il y a, par exemple cette poule qui « évitait de manger abondamment » (p. 48) laquelle, par ce comportement, suscite l’ire de Glaude, qui déclare à sa femme :
« Ne l’ai-je pas vue, devant un picotin d’avoine bien fraîche, flairer les grains, les regarder de travers, en grignoter un ou deux puis s’en aller, ayant peu mangé ? Peut-on attendre rien de bon d’une petite bouche ? Crois-moi, la bourgeoise, ne te fie dans la vie qu’à ceux qui ont bon appétit, franc gosier et le reste ! De ceux-là seuls on peut attendre un coup de main. »
Passage comique du roman, cet épisode de la poule qui refuse de manger se termine en liant appétit de chère et désir de chair : le narrateur s’aperçoit, alors qu’il ouvre la poule, morte et déplumée, qu’il lui manque le « sot-l’y-laisse » (p. 55) :
« Or celui-là [le croupion] n’était ni rose, ni épanoui, mais pâle, mais triste ! J’y mis un doigt dédaigneux…horreur ! là où chaque poule a un orifice bien douillet qui s’entrouvre comme un calice pour recevoir le soleil, celle-là ne présentait qu’une surface bien lisse, brillante comme le creux de la main, bleuâtre un peu, comme une paupière fermée. Œil fermé sur l’amour, et clef du mystère de sa vertu et de son martyre, que j’avais pris hélas longtemps pour du pharisaïsme. »
Sans appétit et imperméable à tout désir, la poule du Livre de raison est le symbole de tout ce que le personnage de Glaude Bourguignon, et Vincenot avec lui, rejettent : au contraire, le programme annoncé en épigraphe, primum vivere, s’applique à tous les domaines de l’existence. Ici plus que jamais, l’horizon culinaire d’Henri Vincenot se rapporte à « une manifestation solennelle de l’amour de la vie »[37]. Le Livre de raison se conclut sur cette double célébration de la chère et de la chair (p. 181) :
« Le repas est expédié, la séance est levée. Justice est faite. Alors, pendant que tout le monde s’occupe à divers travaux, ma femme me cligne de l’œil en souriant à sa façon. Puis elle disparaît. Je la suis sans en avoir l’air. Elle m’attend dans la pièce voisine, m’attire près d’elle, s’enlace de mes deux bras confus en me disant :
"Que je t’embrasse comme il faut !" »
En Bourguignons salés[38], Glaude et sa femme achèvent de donner tout leur relief aux horizons culinaires d’Henri Vincenot, qui déclinés de réminiscences en enluminures mystiques, de recettes traditionnelles en digressions géographiques, jusqu’au simple bonheur d’avoir le ventre plein au sein d’un foyer aimant, tracent les contours d’un ensemble hétéroclite et polymorphe.
Derniers plats de cette « paulée »
Pour prolonger le festin auquel nous invite Vincenot, il faudrait encore évoquer un ensemble d’œuvres que la postérité retient sous le nom de « fresques de Santenay ». Réalisées à l’été 1947, ces grandes toiles, peintes par Vincenot pour décorer les murs de l’école de Santenay (près de Chagny), représentent notamment les quatre saisons, les travaux de la vigne, des scènes de récolte, de chasse, et de banquets, de noces et de danses[39]. Œuvre colorées et riches de détails, hymnes à la vie rurale et la joie, elles synthétisent presque, sur un plan graphique, le tour d’horizon culinaire que nous venons de vivre. Toujours autour de la thématique du banquet, Vincenot écrit La paulée[40], nouvelle dont le titre est programmatif. Le narrateur, montagnard attiré par le bruit, les couleurs et l’éclat des vendanges autour de Saint-Romain (non loin de Beaune), descend vers les vignes et rencontre « l’agressive jovialité de ces êtres de vie, aux faces joyeuses et rougeaudes, aux voix vibrantes »[41]. C’est le point de départ d’une « ivresse » nouvelle, qui se termine dans « le ciel laiteux de l’aurore »[42], après un banquet abondant en mets, en vins et en paroles, car « chez nous, voyez-vous, un plat vous régale dix fois plus quand on parle »[43]. Il nous faudrait encore évoquer la cuisine de la Gazette, le chemineau du Pape des escargots, capable de transfigurer les geais et les « sauvagines » qu’il piège dans des ragoûts mystiques, ou encore le rythme envoûtant des vendanges à la bourguignonne, qui entraîne dans une ronde joyeuse les constructeurs de chemin de fer, dans La Pie saoule, et bien d’autres ouvrages qui accordent une large place aux motifs que nous venons d’exposer.
Mais revenons au commencement et à cette scène finale de La Billebaude, qui scelle une première union entre le narrateur et la jeune femme des Maranges, autour d’un festin typiquement bourguignon, très symbolique, comme nous l’avons démontré. Henri Vincenot relate dans un texte demeuré manuscrit, « La folie de ma vie jusqu’à ma mort », le moment qu’il a vécu avec celle qui n’était pas encore sa femme, dans ce qui est un hypotexte de la scène finale de La Billebaude. Comme dans le roman, il mène la jeune femme dans les ruines du hameau de « la Peurrie », où ils se restaurent tandis que Vincenot fait part de son désir de rebâtir le hameau, et de le faire avec une femme. Dédié à ses petits-enfants et présenté comme « [s]on histoire, la vraie »[44], ce texte est intéressant pour comprendre l’évolution littéraire de La Billebaude. Il présente un détail culinaire surprenant, sur lequel s’achèvera ce rapide tour des horizons culinaires d’Henri Vincenot, qui, par amour, ont même fini par dépasser le cadre du « Toit du monde occidental » :
« [Andrée] – …Il faudrait un couple – une famille…
[Henri] – Oui... un couple… une famille…mais où trouverais-je la fille…
C’est à ce moment, et sur ce beau mouvement oratoire que nous nous donnâmes le premier baiser.
Le veau Marengo brûla et prit au fond.
Les pommes de terre furent calcinées.
Je ne me souviens pas avoir jamais fait un aussi bon repas. »
Par Odin Georget
Notes
[1] Henri Vincenot, La Billebaude, Paris, Gallimard, « Folio », 1982 (Denoël, 1978). Nous citerons toujours dans cette édition.
[2] Si cette anecdote est relatée dans La Billebaude, Vincenot raconte en détail et sans romancer les conditions de sa trouvaille, dans un texte intitulé « La folie de ma vie jusqu’à ma mort », qui ne fut jamais publié, et d’où sont tirés les éléments contextuels du début de cet article.
[3] Voir Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, « Banquet », Dictionnaire des symboles [1969], Paris, Robert Laffont-Jupiter, « Bouquins », 1982 (1969), p. 121.
[4] Thème apprécié par Vincenot, qui y consacra son dernier roman, L’Œuvre de chair (Paris, Denoël, 1984).
[5] Claudine Vincenot, Henri Vincenot, La Vie toute crue, Paris, Anne Carrière, 2006, p. 628.
[6] Henri Vincenot, Je fus un saint, Paris, Denoël, 1953.
[7] Famille Vincenot, Cuisine de Bourgogne, Paris, Denoël, « Cuisines du terroir », 1980 (1979). Nous citerons dans cette édition.
[8] Claudine Vincenot, Henri Vincenot, La Vie toute crue, op. cit., p. 628.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Ce « portrait de famille » est dressé p. 59-62 de La Billebaude.
[12] Ce village est le théâtre principal de La Billebaude et un lieu de résidence d’Henri Vincenot, qui vécut entre la maison familiale et son hameau à la fin des années 1960 (retraite de la S.N.C.F.). Il occupe, avec Châteauneuf-en-Auxois, le centre du « Toit du monde occidental » sur lequel nous aurons à revenir dans cet article.
[13] Claudine Vincenot, Henri Vincenot, La Vie toute crue, op. cit., p. 628.
[14] La « Montagne » : terme fort utilisé par Vincenot dans l’ensemble de son œuvre pour désigner les monts qui bordent la plaine du Pays-Bas dijonnais et forment une barrière calcaire qui la sépare de l’épine dorsale bourguignonne qu’est le Morvan.
[15] Terme sans doute inspiré de sa découverte des « ymaigiers » de Philippe le Hardi, Jehan de Marville, Jean de la Huerta (cités dans Le Pape des escargots notamment). Des manuscrits de Vincenot sont signés « Henri Vincenot, imagier-sculpteur ». Se référer à Claudine et Denis Vincenot, Le Peintre du bonheur, Paris, Anne Carrière, 2001, p. 10.
[16] Paris, Denoël, 1972.
[17] Claudine Vincenot, Henri Vincenot, La Vie toute crue, op. cit., p. 21-41 et 58-73.
[18] Paris, Anne Carrière, 1997.
[19] Paris, Anne Carrière, 2012.
[20] Paris, Hachette, 1976. Vincenot avait déjà collaboré à cette collection en 1975 pour La Vie quotidienne dans les chemins de fer au XIXe siècle.
[21] Paris, Rivages, 1984 (ill. Alain Turpault).
[22] La Billebaude, p. 98.
[23] La « chambre dolménique » est un thème cher à Vincenot, notamment développé dans Le Pape des escargots, où le personnage de la Gazette voit, entre autres dans les cryptes de Vézelay, Saint-Bénigne de Dijon et Saint-Philibert de Tournus, la continuation chrétienne d’une croyance celte.
[24] Cuisine de Bourgogne, p. 51.
[25] Claudine Vincenot, Henri Vincenot, La Vie toute crue, op. cit., p. 345-346.
[26] Gaston Bachelard, La Psychanalyse du feu, Paris, Gallimard, « Idées », 1965 [1938], p. 19.
[27] La Billebaude, p. 341.
[28] Paris, Denoël, 1982.
[29] Cette série de termes empruntés au vocabulaire de l’alchimie marquent d’une présence abondante Le Pape des escargots, La Billebaude et Les Étoiles de Compostelle.
[30] Claudine et Denis Vincenot, Le Peintre du bonheur, Paris, Anne Carrière, 2001, p. 9.
[31] Cuisine de Bourgogne, p. 52.
[32] Ibid., p. 53.
[33] Henri Vincenot, Le Livre de raison de Glaude Bourguignon, Paris, Gallimard, « Folio », 1990 (Paris et Précy-sous-Thil, Denoël et Les Éditions de l’Armançon, 1989). Nous citons d’après cette édition. Nota : Glaude est une variante du prénom « Claude », très utilisée par Henri Vincenot dans ses romans.
[34] Il est mobilisé à la 472e compagnie hippomobile, mais une cardiopathie mitrale entraîne son rapatriement (Claudine Vincenot, Henri Vincenot, La Vie toute crue, op. cit., p. 404).
[35] Ibid., p. 437.
[36] Le braconnier est un motif vivement important dans l’œuvre de Vincenot, de Glaude Bourguignon au Tremblot de La Billebaude en passant par la Gazette du Pape des escargots. Symbole d’une marginalité rendue nécessaire par la marche de la société, le braconnage demeure pour Vincenot un symbole de liberté et d’indépendance au sein d’une nature encore sauvage, dans laquelle peut s’exprimer pleinement la joie de vivre et le besoin d’espace de l’être humain.
[37] Cuisine de Bourgogne, p. 52.
[38] Expression régulièrement reprise par Henri Vincenot. (Cf. Ma Bourgogne, le Toit du monde occidental, Paris, Jean-Pierre Delarge, « Terres de mémoire », 1979, p. 144).
[39] Ces toiles figurent dans Claudine et Denis Vincenot, Le Peintre du bonheur, op. cit., p. 58-73.
[40] Henri Vincenot, Récits de friches et des bois, Paris, Anne Carrière, 1997, p. 93.
[41] Ibid., p. 97
[42] Ibid., p. 109.
[43] Cuisine de Bourgogne, p. 41.
[44] Texte non paginé.