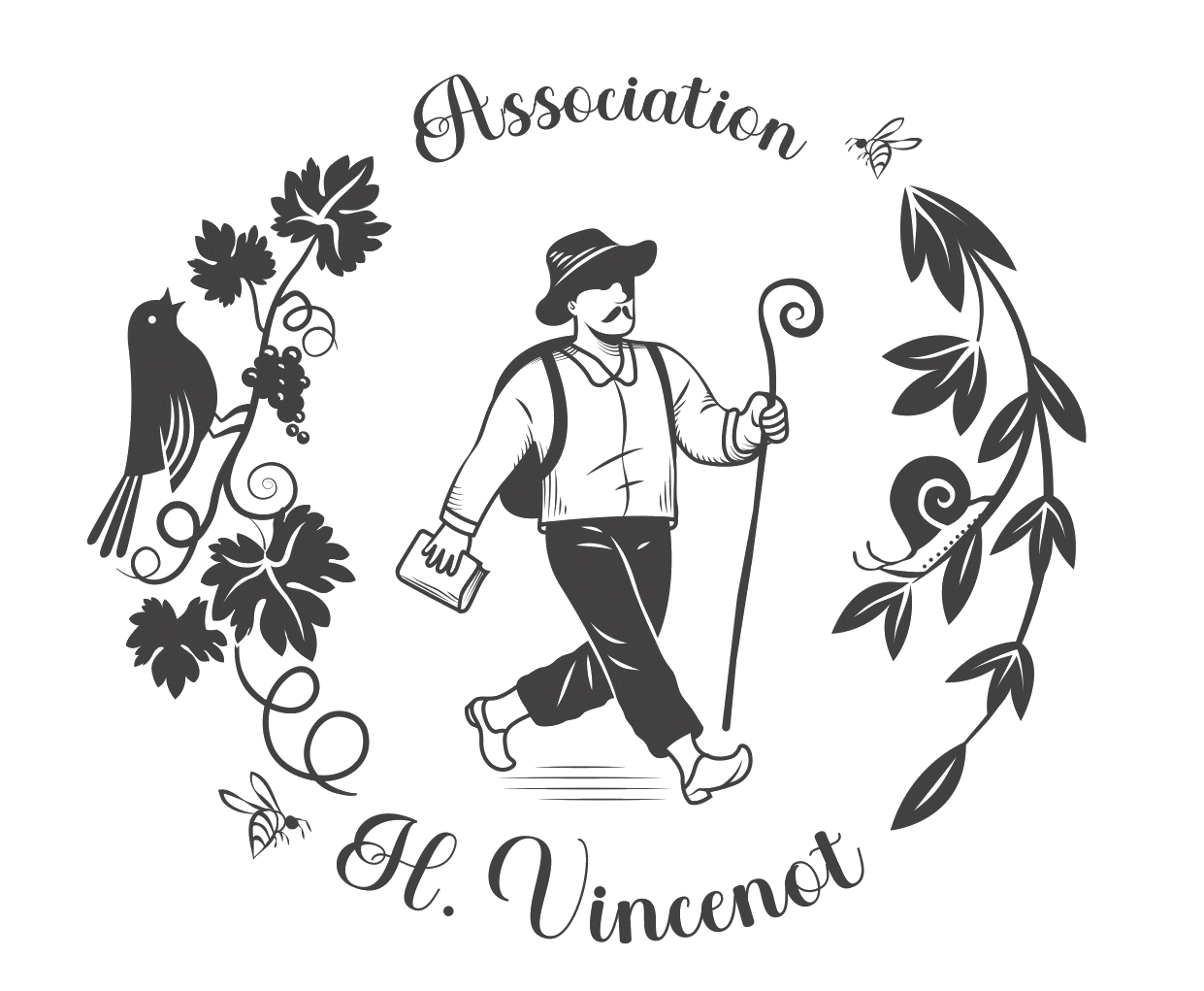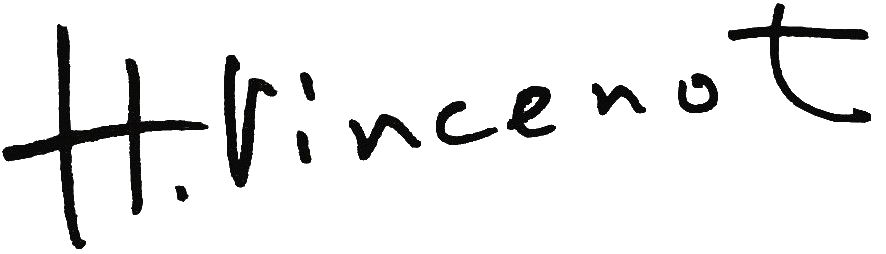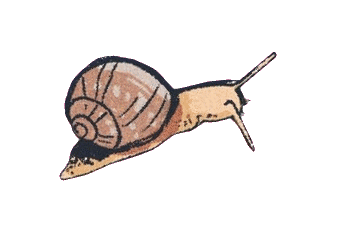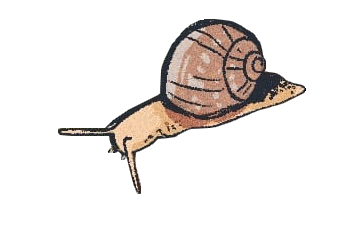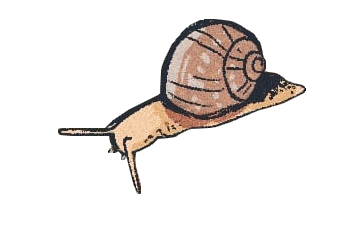Mai-Juin 2024
Vincenot 1978

Affiche promotionnelle pour une séance de dédicaces à Chalon-sur-Saône, 1978.
1978 est une date charnière dans le parcours littéraire d'Henri Vincenot. Retour en quelques lignes sur cette acmé qui vit notamment paraître La Billebaude.
Au moment de la parution de La Billebaude, en 1978, Henri Vincenot est l’auteur de neuf romans (chez Denoël, où il est édité depuis 1953[1]) et de deux ouvrages pour la collection Hachette « La vie quotidienne[2] ». Alors qu’il est déjà connu à une échelle régionale[3], Jacques Chancel est le premier journaliste français à lui ouvrir les portes d’une émission nationale – Radioscopie – le 16 avril 1975.
Son exposition médiatique commence donc véritablement après la parution du Pape des escargots, en 1972 (Denoël), qui attire l’attention de Gérard Gautier[4], éditeur français en poste en Suisse, puis de Gérard Valbert[5], animateur de l’émission littéraire de la Radio Suisse Romande. Ce dernier invite Vincenot : c’est le début d’une réussite non démentie et d’une notoriété croissante, confirmée par les six émissions Apostrophes qui suivirent, de 1977 à 1984, lesquelles ont fixé l’image de l’écrivain qui demeure encore aujourd’hui.
Ces deux romans attirent l’attention du public et remportent un important succès[6]. Ils semblent complémentaires à plus d’un titre : ils se situent dans le même cadre spatial : l’Auxois, Paris, et certains lieux de part et d’autre de la Bourgogne[7]. Ils mettent en scène un personnage de chemineau, la Gazette, fou et sage, prophète et affabulateur, qui joue du sublime et du vulgaire dans une dialectique oxymorique chère à Vincenot[8]. Ces deux romans ont la particularité de partager une genèse très similaire : Vincenot écrit les premières moutures de ces deux livres durant la Seconde Guerre mondiale[9]. Après trente ans de gestation, il les corrige, les complète. La parution de La Billebaude marque l’apogée de son œuvre littéraire : le livre se distingue par un style différent des productions antérieures. Cette Billebaude de 1978 intègre des éléments biographiques véridiques, qui tiennent parfois de la restitution d’un caractère, ou d’un événement : la découverte du hameau de la Peurie constitue le cœur de cet ouvrage. Œuvre d’une vie, le hameau est, dans le roman comme dans la vie de son auteur, le « terreau du futur et non fief du passéisme, car la tradition, la vraie, celle qui, étymologiquement, « se transmet », est porteuse d’avenir et non stérile repli sur soi[10]. »
1978 est une date clef dans le parcours d'Henri Vincenot, parce que la décennie qui débute huit ans plus tôt voit l’auteur, retraité de la SNCF[11], publier un grand nombre d’ouvrages. Son premier succès d’ampleur, Le Pape des escargots, a paru six ans plus tôt. Il évoque la sculpture et l’art roman bourguignons ; quatre ans auparavant a paru Le Sang de l’Atlas, roman cher à Vincenot entre tous[12], qui témoigne de son intérêt pour la culture berbère. 1980 est enfin la date de parution du Rempart de la Miséricorde[13], motif symétrique autofictionnel et ferroviaire de La Billebaude. Dans le même esprit, paraissent deux ouvrages dans la collection Hachette de « La vie quotidienne » : l’un est consacré à la terre[14], l’autre au chemin de fer[15], un autre, sur la cuisine[16] de Bourgogne, paraît également. Il y a donc, à l’issue de cette décennie et au moment du tournant que symbolise l’année 1978, une dialectique qui se détache de l'œuvre de Vincenot et qui répond aux questions qu’ouvrait, avec la décennie, Le Pape des escargots, quant à la notion de passé, de tradition : Henri Vincenot est un écrivain du mouvement, du dialogue ; pas l’écrivain du temps d’avant, mais celui de la transition, du bouleversement.
Plus loin de que le vernis païen, truffé de symboles ésotériques appliqués à une conscience profondément chrétienne[17], Henri Vincenot nourrit la réflexion d’un artiste qui poursuit l’espoir que lui suggère la première, par son importance, de toutes ses créations : le dépassement de cette forme de mort que constitue l’oubli, la conjuration des disparitions patrimoniales, qu’elles soient de nature humaine – comme le hameau de la Peurie – ou qu’elles relèvent de la nature – ce que signale son attachement aux « friches et aux bois[18] ». C’est ainsi que La Billebaude s’achève sur un regard lancé par le narrateur et sa future femme – qui se prénomme Andrée, comme la femme de Vincenot, la mère de ses enfants – sur le hameau perdu, promesse d’un futur fécond :
Avant de reprendre nos vélos, nous nous sommes retournés pour regarder encore une fois la combe, et je ne sais plus lequel de nous deux a prononcé cette phrase:
- Il est grand temps qu’on s’en occupe !
Le sort en était jeté ! C’était le commencement d’un nouvel âge pour le vieux pays[19].
Loin d’être un auteur purement nostalgique, réactionnaire ou simplement régionaliste, Henri Vincenot, en 1978, est plus que jamais « l’anarchiste contemporain[20] » qu’il prétendait être à la fin des années 1950, même si son audience a crû. Son hameau de « La Peurie » enfin ressuscité, Henri Vincenot livra à la postérité la singularité de son regard sur la Bourgogne, point de départ de tant de billebaudes, de tant de voyages et de redécouvertes ; et ce n’est pas le succès médiatique ou Apostrophes qui l’empêchèrent de « [se] repaître d’immensité, de silence, de liberté[21] » au sein des lieux qu’il défendit comme ceux qui permirent que s’épanouissent son art, son amour, sa famille.
Par Odin Georget
[1] Claudine Vincenot, Henri Vincenot, La Vie toute crue, Paris, Anne Carrière, 2006, p. 541-542.
[2] Ibid., p. 606 et p. 617.
[3] Comme le témoignage la « Revue de presse » du « Fonds Vincenot de la Bibliothèque patrimoniale et d’étude de Dijon.
[4] Claudine Vincenot, Henri Vincenot, La Vie toute crue, op. cit., p. 605 et Gérard Gautier, « Un auteur, un éditeur », Rencontres Henri Vincenot, Dijon, 1993, p. 125-126.
[5] Ibid.
[6] Ce que démontrent les ventes, consultables au « Fonds Vincenot » de la Bibliothèque patrimoniale et d’étude de Dijon, cote Ms 4548. Le « Revue de presse » le confirme de même.
[7] Vézelay, Tournus, ou certains sites mégalithiques des quatre coins de la région en sont quelques exemples.
[8] L’avant lire de son premier roman énonce les éléments de cette poétique, par exemple : « Sous Calvin je suis papiste. Sous Richelieu, je suis parpaillot. – Ce n’est pas par esprit de contradiction, c’est par amour de l’équilibre. » Henri Vincenot, Je fus un saint, Paris, Anne Carrière, « Le livre de poche », 2002, p. 11.
[9] Claudine Vincenot, Henri Vincenot, La Vie toute crue, op. cit., p. 598 et p. 621. C’est également vérifiable en consultant le « Fonds Vincenot », cote Ms 4537, « Notre vie cahier n°3 », p. 118.
[10] Henri Vincenot, Les Livres de la Bourgogne, Paris, Omnibus, 2001, p. XIV.
[11] Claudine Vincenot, Henri Vincenot, La Vie toute crue, op. cit., p. 593.
[12] Ibid., p. 615.
[13] Paru initialement sous le titre Mémoire d’un enfant du rail, chez Hachette. Réédité, avec le titre souhaité par Vincenot en 1998, chez Anne Carrière, Paris.
[14] Henri Vincenot, La Vie quotidienne des paysans bourguignons au temps de Lamartine, Paris, Hachette, 1976.
[15] Henri Vincenot, La Vie quotidienne dans les chemins de fer français au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1975.
[16] Famille Vincenot, Cuisine de Bourgogne, Paris, Denoël, 1979.
[17] Derrière les abondantes références paganisantes – notamment celles des Étoiles de Compostelle – il ne faut pas perdre de vue l’importance de premier plan de la figure du Christ dans l’œuvre de Vincenot. Se référer à son œuvre peint et sculpté, ou encore Madeleine Blondel, « Giselbertus hoc fecit », Rencontres Henri Vincenot, Dijon, 1993, p. 39-60, et aux ouvrages de Claudine Vincenot, qui le prouvent chacun.
[18] Se référer notamment à Henri Vincenot, Récits des friches et des bois, Paris, Anne Carrière, 1997.
[19] Henri Vincenot, La Billebaude, Paris, Denoël, 1978, p. 423.
[20] Se référer notamment à Henri Vincenot, Les Yeux en face des trous, Paris Anne Carrière, 1959.
[21] Ibid., p. 246.