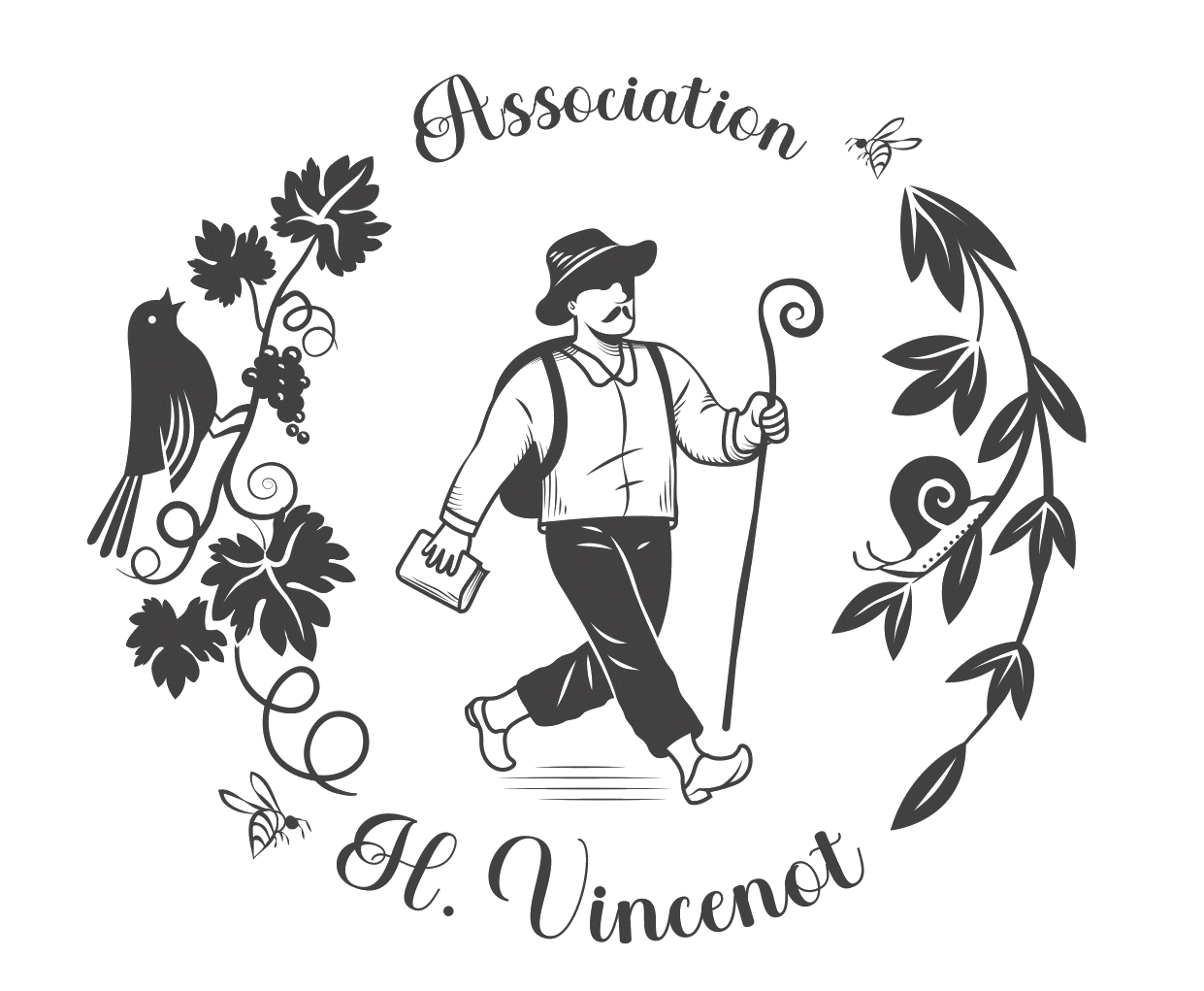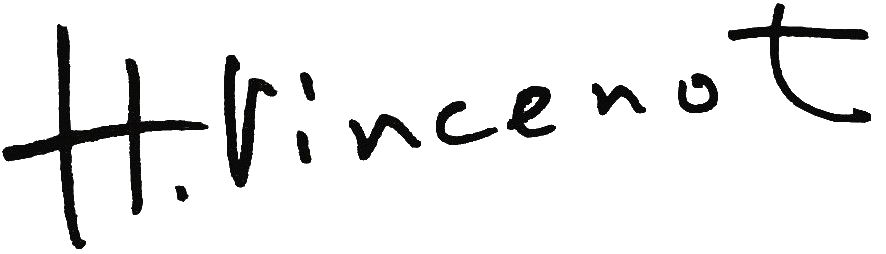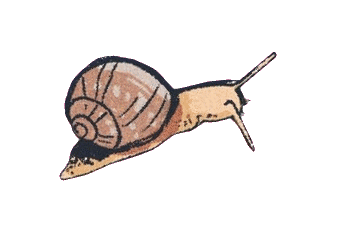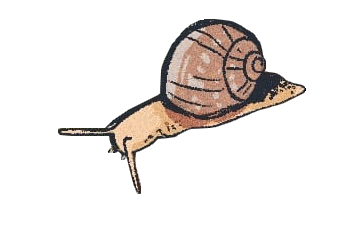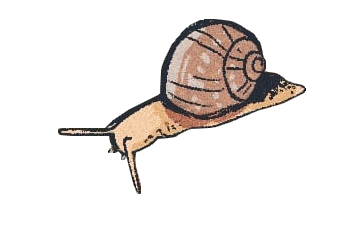Septembre-Octobre 2024
Henri Vincenot et le dernier charbonnier
Les mois de septembre et d'octobre marquaient, selon Gérard Boutet[7], la fin de la saison de cuisson pour les charbonniers qui peuplaient jadis les bois des monts bourguignons.
En 1983, Henri Vincenot participe au reportage de Damien Rabeisen sur le dernier charbonnier de Marsannay-la-Côte, Monsieur Daniel. Tourné en Super 8 pour le concours de l'émission « Course autour du Monde », le reportage de Damien Rabeisen, journaliste à France 3 Bourgogne, est diffusé sur France 2, puis sur France 3. Henri Vincenot apparaît à l'image et récite un texte de commentaire. C'est ce document que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui, suivi d'un article sur Denis Cornu, le charbonnier de La Billebaude décrit par Henri Vincenot cinq avant ce reportage.
Nous remercions Damien Rabeisen, qui a gracieusement accepté la diffusion de son travail sur notre site.
Le dernier charbonnier, DR Damien Rabeisen.
« Nous, pour avoir chaud, on ne descend pas sous terre, on « monte au bois », et c’est le meilleur moment de la vie. En outre, le bois, c’est un moyen de chauffage merveilleux ; ne chauffe-t-il pas six fois ? Une fois quand on l’abat, une fois quand on le moule, une fois quand on le débarde, une fois quand on le scie, une fois quand on le fend, et enfin quand on voit sa flamme. »
C’est en ces termes qu’Henri Vincenot rend hommage aux forestiers, dans son roman La Billebaude[1]. L’ouvrage, qui se déroule environ des années 1920 au milieu des années 1930 est l’occasion pour Vincenot de faire revivre, à travers un récit d’enfance romancé, quantité de métiers de la « Montagne bourguignonne[2] ». Activités agricoles, artisanales et rurales qui, en ce début de siècle, commençaient à subir la concurrence de la mécanisation
Vincenot ethnographe : les métiers ruraux au début du XXe siècle
Le lecteur découvre ainsi le grand-père maternel du narrateur, Tremblot, qui est « maître bourrelier, compagnon du Tour de France[3] », et se consacre aussi à l’apiculture, à l’arboriculture. Sandrot, son grand-père paternel, est « maître forgeron » (p. 135) et compagnon du Tour de France. Il finit par devenir « mécanicien de locomotive » (p. 137). Le narrateur du roman décrit ses rapports avec les commis de ferme, les faucheurs, les messagers ou rouliers, en chariot comme Jean Lépée (p. 176), ou à pied comme le chemineau la Gazette (p. 185), et autres manœuvres, faucheurs, piocheurs, bêcheurs, bûcherons, scieurs de bois (p. 269), sans oublier les lavandières (p. 270). À cela s’ajoutent les métiers de château et de chasse comme celui de premier piqueur (p. 50), ou des activités liées à la ville et à la bourgeoisie, comme celle de « nourrice morvandelle » qu’exerce la cousine Honorine (p. 68). Le narrateur de La Billebaude s’attarde également sur différentes activités de colportage, notamment représentées à travers l’effrayante Poloche (p. 31), vendeuse ambulante d’allumettes, ou par la Gazette, chemineau-prophète et détenteur de mystérieux savoirs. Ces personnages, toujours en marge de la légalité, sont parfois associés au braconnage, si dépeint dans les romans et nouvelles de Vincenot qu’il semble être un métier à part entière.
Les Récits des friches et des bois[4] présentent eux aussi leur lot de métiers de cette Montagne bourguignonne. Vincenot y dépeint le Téchon, chasseur de vipère, Bobo Chinel, amuseur de noce, la Poloche et la Gazette évoqués précédemment. Il ne manque pas de décrire les activités de la vigne, des vendangeurs aux bareuzais. Mais sa Bourgogne est plus montagnarde et s’étend à l’ouest de la côte viticole. C’est pourquoi priorité semble être donnée aux bûcherons, essarteurs, bergers, qui occupent une place très souvent positive dans ses écrits.
Un charbonnier dans les monts, Denis Cornu
Le métier de charbonnier est l’une de ces activités forestières à laquelle Vincenot consacre plusieurs passages de La Billebaude. Signe avant-coureur de l’arrivée dans la vallée tant aimée, la fumée qui monte du chantier de Denis Cornu, le charbonnier du roman, rassénère le narrateur qui rentre malade et perclus de Paris (370). L’un de ces chantiers est situé « dans le bois des Roches face au grand panorama » (p. 385). Le bois des Roches se situe sur les contreforts nord-est de l’éperon de Châteauneuf-en-Auxois, et le panorama dont il est question est sans doute celui qui laisse entrevoir, à qui regarde vers l’ouest, les villages de Vandenesse et de Commarin avec le réservoir de Panthier, chers à Vincenot et, plus loin, les monts du Morvan qui s’étendent au-delà de l’Auxois. C’est dans ce cadre contemplatif et sauvage que travaille Denis Cornu, auprès de qui le narrateur vient apprendre ce que personne ne lui enseigne ailleurs : « On restait tous deux le regard perdu dans les lointains morvandiaux, moi, l’élève, et lui, le professeur, si différents des Demangeon, des Ripert, des Carré et autres que j’entendais à l’école des Hautes Études » (p. 384).
Le jeune narrateur, que sa famille pousse à réussir de brillantes études, ne souhaite pas quitter la campagne de son enfance. Ses grands-pères le voient volontiers « ingénieur » (p. 138), mais le jeune garçon a de tout autres désirs :
« Moi, je voulais être chasseur ! d’abord. Et, accessoirement (car il faut de l’argent pour acheter de la poudre et des chevrotines), bourrelier comme Tremblot, ou forgeron, comme Sandrot, ou encore charpentier comme le grand-père Daudis, pour vivre au milieu des cultivateurs, des chevaux, des foires, des apprentis, des outils, et dans les parfums vitaux du bois, du cuir, du fer et du crottin de cheval !
Ou encore bûcheron-charbonnier. C’était même ce métier de bûcheron qui me tentait le plus, parce que les parfums y étaient encore plus vifs et plus saoulant que n’importe où ailleurs, mais surtout parce que si on a l’outil dans la main et les odeurs plein la tête, la vie sauvage n’est pas loin ! Et quoi de plus roboratif que la compagnie des grands arbres ? » (p. 139)
Guidé par le choix des sens, du « parfum vital »(p. 139), du travail en plein nature, acceptant la perspective du dénuement, le narrateur de La Billebaude est attiré par ce qu’il décrit comme une activité d’alchimiste forestier. Ce que Vincenot nomme « transmutation », notamment dans Le Pape des escargots et Les Étoiles de Compostelle, trouve son expression matérielle dans les travaux du charbonnier qui, à l’instar de Denis Cornu – homonyme de la cornue des alchimistes, qui sert à transformer le gaz en liquide – « construi[t] ses meules à charbon dans le bois » (p. 383), afin de transformer « sept stères de bois en quatre-cents kilos » de charbon, comme le précise Vincenot à la fin du reportage de Damien Rabeisen.
Le charbonnier, alchimiste forestier
La transmutation de la matière est en effet une étape indispensable dans la « transmutation humaine[5] », l’un des sujets principaux des romans qui suivirent Le Pape des escargots. Fasciné par les métiers de ses grands-pères, en particulier par les dons de forgeron d’Alexandre – Sandrot dans La Billebaude – et persuadé que transformer, travailler une substance vous transforme tout autant, Vincenot s’adonne dès sa jeunesse à la sculpture sur bois. C'est sans doute l’une de ses façons de transformer la matière, de la sublimer, de lui faire subir la métamorphose. C'est ce que le personnage de la Gazette appelle « la transmutation du Verbe en Volume[6] ». L’intérêt de Vincenot pour les bâtisseurs de l’époque romane, qui s’exprime dans Les Étoiles de Compostelle, provient à n’en pas douter de cette passion pour la transmutation de la matière, développée ici non pas via les préoccupations métaphysiques voire ésotériques des Compagnons des Étoiles de Compostelle, mais par le truchement d’un personnage que le narrateur décrit comme simple et sage, et dont la maison même est pensée pour la métamorphose :
« Sa maison, à lui, Denis Cornu, était et serait toujours couverte en lave et lorsqu’il travaillait au bois, il vivait toujours dans la cayute des bûcherons, faite par lui, selon les règles, de baliveaux de chêne, en faisceaux, recouverts d’une épaisse coquille de mottes de terre. Il m’expliqua, pour la centième fois peut-être, que les baliveaux de châgne assemblés en forme de cône (il insistait sur ce point) vous attrapaient les courants du ciel par la pointe pour vous les étaler dans la masse de la terre et tout cela formait une sacrée carapace protectrice. » (p. 385)
L’analogie de forme (conique) entre la cahute de Denis Cornu et ses meules à charbon rejoint l'hypothèse que nous avons esquissée quant à la nécessaire transmutation de la matière pour prétendre à la transmutation de l’homme.
L’ouvrage Les Forestiers : vieux métiers des taillis et des futaies[7], de Gérard Boutet, relate les étapes de la fabrication de ce charbon. On découvre à sa lecture que le charbonnier prend en charge l’ensemble du processus de fabrication, de la construction de la meule à l’alimentation en bois, jusqu’au terrassement du terrain qui va accueillir cette meule. Bien sûr, il doit surveiller la cuisson, et ouvrir le fourneau une fois l’opération terminée. Le charbonnier, impliqué dans toutes les étapes de la transmutation de la matière, vit dans une cahute qui ressemble à ses meules et qui, à leur instar, doit le transformer, en captant les « courants du ciel » (p. 385) pour les « étaler dans la masse de la terre » (ibid.). Comme le frère convers Joachim des Étoiles de Compostelle[8], et comme tant d’autres personnages précepteurs sinon initiateurs qui parsèment l’œuvre de Vincenot, Denis Cornu maîtrise la transmutation et confère des bribes de savoir à un personnage plus jeune, désireux de percer tant de mystères.
Entre ethnographie et mystique : la main et le cœur de Denis Cornu
L’évocation des charbonniers, à travers le personnage de Denis Cornu, permet ainsi à Vincenot de rendre hommage à un métier rude, alors proche de disparaître. C’est l’occasion pour lui de décrire ces « friches et bois » non seulement dans l’aspect poétique de leur paysage, mais d’en exprimer la substance par le caractère des personnages qui y vivent et y travaillent la matière. En décrivant la maison et les objets qui peuplent le modeste quotidien du charbonnier, Vincenot brosse le portrait d’une vie rude et simple, parfois tragique, qu’il oppose à la complexification du monde contemporain. Le motif alchimique que nous avons esquissé, lui permet de faire l’éloge de ce que Charles Péguy nomme, dans L’Argent, « la main et le cœur[9] ». L’éloge de la main, c’est la célébration de l’artisanat, de l’effort de l’homme qui, en bâtissant, se métamorphose. « La civilisation qui méprise la main est vouée à la catastrophe… [10]» assène Maître Gallo dans Les Étoiles de Compostelle. L’éloge du cœur, c’est le narrateur de La Billebaude qui l'accomplit, pour ponctuer le récit de ses discussions avec Denis Cornu :
« J’étais tout ému de retrouver ce mysticisme cosmique, ce délire tellurien, cette piété géodésique et cette poésie qui sortait comme eau de source de sa bouche édentée, car Denis Cornu n’avait plus, depuis vingt-cinq ans, aucune dent, ce qui ne l’empêchait ni de casser les noix et les noisettes ni de faire sauter les bouchons, ni de ronger les os, ni de croquer une pomme avec ses gencives devenues dures comme molaire.» (p. 386).
Par Odin Georget
[1] Henri Vincenot, La Billebaude, Paris, Denoël, 1978 (1982), p. 341.
[2] Voir la page 397 de l’opus cité.
[3] Ibid., p. 123. Les prochaines références de La Billebaude seront indiquées entre parenthèses pour plus de commodité.
[4] Henri Vincenot, Récits de friches et des bois, Paris, Anne Carrière, 1997.
[5] Cette expression revient à plusieurs reprises sous la plume de Vincenot. Voir notamment Le Pape des escargots, Paris, Denoël, 1972 (1983).
[6] Ibid. p. 55.
[7] Gérard Boutet, Les Forestiers : vieux métiers des taillis et des futaies, Paris, Jean-Cyrille Godefroy, 1997, p. 72.
[8] Henri Vincenot, Les Étoiles de Compostelle, Paris, Denoël, 1982 (1987).
[9] Charles Péguy, Œuvres en prose 1909-1914, L’Argent, édition de Marcel Péguy, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1961, p. 1105.
[10] Ibid., p. 208.