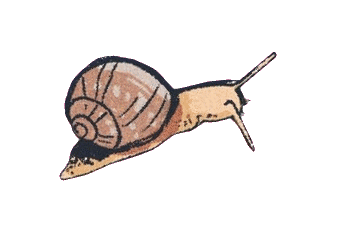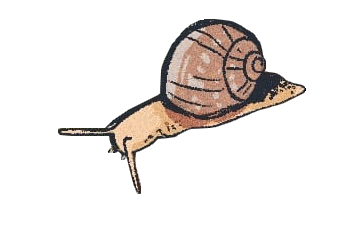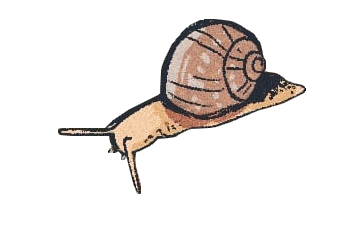Février 2024
Andrée Vincenot, « Belle Eduenne et femme d'artiste », par Claudine Vincenot

Vierge à l'enfant pour Claudine, tilleul, 1938, DR Coll. particulière.
Que proposer d'autre, pour ce mois de février synonyme de Saint-Valentin, qu'un texte qui met à l'honneur la muse d'Henri Vincenot, le pilier de son œuvre, sa « Béatrice » : Andrée Vincenot. Née le 13 octobre 1913, elle rencontre Henri à Dijon, pendant leurs études. Ils ne se quitteront plus.
Représentée dans ses tableaux, dans ses romans, ou encore, modèle pour ses statues (comme pour la Vierge à l'enfant ci-dessus) Andrée est omniprésente dans la vie d'Henri comme dans la fiction.
Elle inspire notamment le personnage féminin que rencontre le narrateur de La Billebaude. Emmenée dans les ruines du hameau par le jeune homme, elle a soin de réanimer le feu dans la cheminée du bâtiment en ruine, et symboliquement de « fonder un foyer » (Henri Vincenot, La Billebaude, Paris, Denoël, p. 316) .
C'est donc avec une grande fierté que nous publions ce texte inédit de Claudine Vincenot qui, rendant hommage à sa mère, manifeste la force du lien qui unit l'écrivain et sa muse.
« Tout sur ma mère »
Belle Eduenne et femme d'artiste.
Quand j’évoque ma mère, c’est ma mémoire qui chante…, Elle qui ne chantait jamais ! « Je chante faux mais j’entends juste ! » ironisait-elle avec son bel accent rond des Maranges. Les seuls refrains qu’ elle entonnât jamais furent les louanges de mon père : très amoureuse, elle l’admirait, l’encourageait et le houspillait tout autant ! Il obéissait avec un baiser discret et un « Mais oui, ma toute belle ! » :
« Heureux homme, dans la présence de la Femme, de Ma femme, la seule femme qui soit au monde. Oui, heureux homme : notre idylle conjugale est si belle, si grandiose que ma joie dépasse celle que j’imaginais à dix-huit ans en rêvant à l’amour ! »( inédit 1941)
Mais Elle, qu’en dit-elle ? Pudique et truculente, réservée et enthousiaste, elle sait dès les premiers instants : « Tu n’es pas comme les autres et c’est pour ça que je t’aime. » Non, il n’est pas comme les autres : diplômé d’HEC, fils de fonctionnaire rangé, il ne rêve que « veurdées » dans la sauvagerie, vie de pionnier, fuite bien loin des villes, des bureaux et des hommes, avec femme forte et fidèle, enfants drus et intrépides… Elle le suit sur ce chemin-là, joie au cœur, fleur aux dents.
Mais Elle, qui est-elle ? Fille d’un dinandier-forgeron à St Léger-sur-Dheune, descendant d’une famille de flotteurs de bois venant de Clamecy, c’est donc une femme de Saône-et-Loire … et « ç’ost pas rien ! ». Son père, Justin, est adroit, artiste, poète et joyeux vivant malgré les malheurs. Il trouvera, en son gendre, le compagnon idéal pour les billebaudes à travers leurs deux Bourgognes, les gôguenettes à l’Alphonse Allais et les discours sans fin sur la vraie joie de vivre, la sottise des pisse-froid et des culs-bénits qui leur font grand’pitié.
Sa mère, Marie-Louise, est fille de meunier sur la Dheune. Mariée à Justin, elle s’installe à la quincaillerie à côté du canal, en plein bourg : Justin a forgé à l’étage un balcon d’arabesques ventrues au cœur duquel il inscrit ses initiales : JB. Elles y sont encore…Pendant ce temps, l’époux tient, dans la rue de la Gare, son atelier de quelques artisans, où se fabriquent des alambics : il aime le métal, bien sûr, mais le cuivre surtout, le rouge, qu’il sait marteler avec talent.
Les aléas de la vie - la mort de deux enfants - (mais, par bonheur, l’arrivée d’une petite sœur pour tromper le chagrin,) - et la toute-puissance du Creusot face à l’artisanat - conduisent la famille Baroin à Dijon. Andrée prépare l’entrée à L’ESC, rue Sambin. Les étudiants –il n’y a qu’une dizaine de filles à l’époque-, la surnomment « Peau de pêche » : « sa chevelure, noire et brillante » est roulée en un chignon lourd sur la nuque, sa peau, « dorée et veloutée comme un abricot », « ses joues couleur des grenadines du Gharb », elle est «belle comme la montagne, comme la forêt » et ses yeux sont clairs, telles des noisettes mûrissantes. (entre guillemets : inédit 1941)
Elle y rencontre Henri Vincenot et ses bons copains Marcel et Gabillot, tous fous de randonnée, de pêche et de petit braconnage insouciant. Après les cours, ils épuisent l’ardeur de leurs vingt ans dans des dégringolades aux cris d’Apaches : roches de Plombière, Combe à la Serpent, encore vierge, Combe aux Fées, pure alors comme une enfant de Marie, et en des courses éperdues dans le vent sur le plateau de la Crâ ou celui de Corcelles, jusqu’au col du Leuzeu souvent.
Fourbus, étincelants de sueur et éclaboussés de fous-rires, ils se jettent dans l’Ouche glacée ou à l’ombre d’un saule et, là discutent sans fin : amour, mariage, chasteté, fidélité, grands espaces vierges à conquérir : Afrique, Canada…et Bourgogne profonde.
Andrée est la seule fille du groupe- elle n’aime « ni les chichiteuses ni les coquettes folles de leur corps »- ce sont ses mots- et n’est pas en reste pour donner la réplique à ces trois garçons. « C’est une fille robuste, bien jambée, bien hanchée ; elle court comme un éphèbe et nage comme un poisson. Elle aime le plein air, la pleine eau, les friches et les bois…tout comme moi. » (ibid.)
Copains ils sont, mais « copains-copains », comme à l’époque, et c’est sans idée derrière la tête qu’ils discutent, relancés par Henri qui vient de lire Bachelard : oui, il aime, par la provocation, la contestation, aller jusqu’au sophisme voire le paradoxe, avec la courtoisie amusée qu’on lui connaît. Il fait son petit Socrate, son accoucheur d’esprits : Andrée est émerveillée. Plus tard, dans notre adolescence, lors des repas du soir, mon père nous appliquera sa méthode…mais Andrée s’exclamera : « Voilà le petit Henri qui fait son malin !! » Et, « pas pris », il répondra : « Mais, Maman, tu sais bien que je suis pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour ! ». C’est un « fan » de Pierre Dac.
De ces « veurdées » sauvages, Andrée et Henri nous en parleront tout au long de nos jeunes années : « Tu te souviens, p’tit loup, quelles belles balades… ! »
Oui, belles balades…
Baladalada, Baladalada …,
Un homme, une femme,
Main dans la main, regards accrochés à la même étoile….
Puis vinrent HEC et Paris, le Maroc ensuite. Elle attendit. Alors les amoureux se marièrent. Puis déferlèrent la guerre, la mobilisation, l’exode : Andrée, enceinte d’un troisième enfant, François, ses deux aînés, Jean-Pierre et Claudine, marchant à peine, partit vers le sud en voiture avec Charles et Marguerite, parents d’Henri. Lui, seul en vélo dans la grande débâcle, pédalait sur les routes du Périgord où il avait été convenu qu’il retrouverait sa famille. Ils ne se retrouvèrent que par hasard, qui fait parfois bien les choses…
De retour en Bourgogne, Henri et Andrée entendirent à nouveau les appels de la forêt : ils entreprirent l’aventure de la Peurrye, ce hameau cistercien en ruine, perdu dans une petite combe de l’Ouche, où avait trouvé refuge un camp de Résistants, le camp du Malgache de célèbre mémoire. L’abattage du bois de chauffage et l’arrachage des pommes de terre pour « ma girliquouée d’petiots », comme aimait dire ma mère. Elle était là, derrière Henri, serpe en main pour élaguer puis façonner les fagots, pendant qu’il abattait à la cognée avec des « Han ! » qui résonnaient dans la combe. Ils jubilaient !
Cette histoire de résistance se conclut par l’arrestation d’Henri: la Gestapo, un beau matin, vint l’interpeller chez nous, à Talant. Depuis le QG, rue du Docteur Maret, il échappa à la sentinelle, essuya un coup de feu et s’enfuit dans les bois, qu’il connaissait si bien. Elle, le regard net, fit front aux officiers allemands et à leurs perquisitions pour retrouver l’évadé.
Pour clore cette période mouvementée que tant d’autres connurent, le médecin annonça aux parents que Jean-Pierre, leur premier-né, était sourd-muet. Andrée tint bon : « Eh bien, on va faire ce qu’il faut ! », c’est-à-dire : partir à Paris. Mais il était trop tôt : la guerre n’était pas finie. Henri, malgré la grande frousse et les blessures, consacrait ses instants volés aux travaux de survie, à l’écriture d’une page, à la pochade de l’Ouche sous tous les ciels, à la sculpture d’un morceau de tilleul ou de chêne. Et Andrée était là, sans geindre ni rouspéter jamais , contemplant et admirant toujours : « C’est é-pa-tant, mon p’tit loup ! ». Tout en torchant les marmots, mitonnant les topinambours, ou jetant du grain aux poules….Quelle belle enfance vous nous avez donnée là, les Parents !
Comme le dit si bien Brassens, le poète…
« Papa, Maman, en chantant cette chanson, Maman, Papa, je redeviens petit garçon »,... Oui, je redeviens petite fille…et je chantonne , pour toi, ma Mère :
« Oh Mummy, Oh, Mummy, Mummy blues,… »…et comme Nicoletta, j'ai des accrocs à l’ âme…
Arrière, mélancolie ! C’est ma mère, encore, qui me rappelle à l’ordre. Sa rudesse affectueuse nous remettait en selle pour la journée : « Tu ne vas pas chouiner !? Allez ! Du cran ! Suis ta route ! »
Notre route, précisément, nous conduisit à Paris pour la raison que j’ai dite. Nous étions en mai 1945. Denis, « the last but not the least” disait mon père, avait un an.
Adieu, poules, lapins, bois, friches et vadrouilles sauvages : la capitale nous piégeait .Ce fut un rude coup mais ma mère tint bon la barre : quatre enfants dans deux pièces, sans salle de bains, le charbon à la cave, pas d’ascenseur pour grimper dans « notre pigeonnier » au cinquième étage. Enfin, tout le confort d’un Paris en fin de guerre ! Henri sut, comme tout bon chasseur, prendre le vent pour débusquer l’optimisme : il emmena sa « smala » veurder à pied dans tout Paris. Et cela, voyez-vous, c’est inoubliable. Quand on découvrait un quartier encore tout de ruelles et d’herbes folles, une église St Séverin bien discrète face à la superbe Notre-Dame, un goûter ashkénaze rue des Rosiers, c’était du rêve pour la semaine. Les Parisiens grasseyant prenaient les parents pour des Slaves, avec leur accent et leurs pommettes saillantes. Et, pour finir, parfois, une limonade à la Bastoche, « chez Laurette,… c’était chouette » !
Tout en allant « au bureau », Henri continuait à écrire dans le métro, à peindre sur les quais, à jouer du piano, à sculpter dans la chambre-salle-à-manger-salon-de-musique-atelier-salle de jeux et ma mère admirait, sans récriminer contre la sciure, le bruit ou les taches de peinture : « Ah ! ça, Henri, les clochards au bord du canal, dans ces camaïeux de gris, c’est une trouvaille ! » (Lecteurs, n’oubliez pas les « r » roulés)
Les clochards, justement : Henri les fréquentait et amenait parfois à la maison, l’air victorieux, un convive de plus. Ma mère avait table ouverte : générosité de Saône-et-Loire ! Un jour, ce fut un Yogi, diaphane et sentencieux. Aimant revigorer son monde, Andrée nous dit à mi-voix et l’œil en coin : « Attends voir ! Il ne doit pas manger à sa faim, cet écrigneûle ! Je vais te le requinquer avec un bon bœuf bourguignon ! ».
Le Yogi ne mangea pas de bourguignon : il ne mangeait que du riz, le yogi.
Il y eut aussi les reportages à La Vie du Rail et Maman restait avec « ses quatre », comme elle disait. Quand Henri revenait après quelques jours d’absence et les poches pleines d’histoires à raconter,…alors…..alors…
« Je me vois prendre ma femme près de moi, en quelque coin sombre, loin des petiots, je me sens ceinturé de ses beaux bras dorés et j’entends déjà sa voix si brûlante répondre à la mienne en un grave et mélodieux murmure, je sens son haleine sur ma peau et j’en ai des frémissements. »(Le Livre de raison de Glaude Bourguignon)
Elle savait lui redonner vie lorsque l’artiste était dans le doute : « Ma femme m’écoutait en souriant. J’ai toujours constaté avec étonnement que mes folies, même les plus inadmissibles, la laissaient souriante. (…). ELLE, avec son bel optimisme et la flamme de l’amour dans les yeux, me disait : « Tu as raison ! »(Journal intime)
Et la vie parisienne dura ainsi, pendant …trente ans au gré des expositions, dont ma mère, avec Henri, sélectionnait les tableaux en donnant son avis ; au cours des lectures à haute voix des textes écrits dans la journée, elle ne se trompait jamais dans ses conseils parce qu’elle avait « du bon sens, du simple bon sens » : c’était le seul diplôme qu’elle revendiquât vraiment.
Elle fit les costumes des pièces de théâtre, pendant que nous aidions notre père à modeler les masques. Elle était partout, disponible, enthousiaste, active et encourageante, une petite mornifle de temps en temps: « Mais faites-donc attention à ce que vous faites, les p’tiots ! ».
C’était dru, c’était vivace, rudement tendre mais sacrément costaud.
Sans le dire, elle accepta mal, plus tard, le départ de ses enfants. Mais bien vite, ils en firent d’autres. Alors, à la retraite à Commarin, pendant qu’Henri allait voir Pivot à Apostrophes ou signer ses livres dans les librairies, elle avait encore des enfants à élever, son vrai bonheur, et continuait, quand son héros rentrait, à donner son sentiment sur les créations du jour qu’il lui présentait, pendant qu’elle mettait bois au feu et confitures en pots.
Et puis, une affreuse nuit d’hiver 83, après avoir pendant quatre ans soigné les parents d’Henri à Commarin, elle eut un malaise grave. Départ précipité en ambulance patinant sur le verglas des routes….
À la clinique, « ils sont venus, ils sont tous là…. », et tous pensent tout bas : on est foutus, on le sent … « ça» rôde, «ça» nous frôle, «ça» nous provoque et « ça » nous nargue …Maman, tu nous échappes, tu nous files entre les doigts, toi, notre reine, notre axe du monde, notre terre, notre ciel, notre vie…Tu ne t’intéresses plus à nous et c’est la première fois. Les blouses blanches qui s’affolent ne voient pas que tu es Notre mère, que tu prends le large à leur insu et que, pour nous, c’est le naufrage …Corps calme, enfin calme, et lisse et doux et blanc avec un pauvre petit cœur qui flanche. En pleine déroute, mon père lui ferme les yeux, puis il se redresse et nous prend en mains : «Les p’tiots, il faut partir… elle n’est plus là, la Maman…Elle est morte d’avoir tout donné…C’est fini pour moi, maintenant ; c’est du rab… »
Il ne lui survivra que le temps du désespoir, fatal.
Par Claudine Vincenot